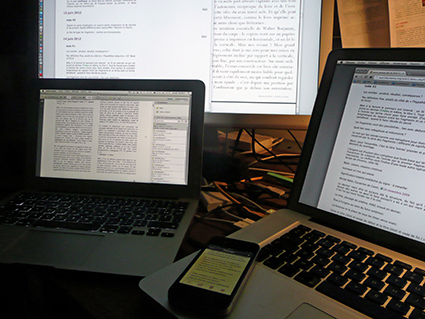Outils pour utilisateurs
Table des matières
START
état des choses/mode d'emploi/index entrées/premières pages/
passage des possibilités/bâtir/c'est un livre/
carnet scribe/carnet éditeur/ carnet lecteurs/chronique revues/
totem/version chiffrée/version exposée/
passage des possibilités
passage des possibilités. Un nouveau carnet, — en correspondance, on pourrait dire, avec le carnet du scribe (notes prises pendant l'élaboration du projet) —, commencé en cette période de creux (septembre 2011-avril 2012) où je suis partie à la recherche d'un nouvel éditeur. Il s'agit toujours d'accompagner du temps (cette fois-ci, celui qui porterait le projet éditorial à son terme) tout en pensant à l'après. Une occasion pour reconnaître le bienfait de la lecture du livre de François Bon, Après le livre puisque c'est la rencontre qui m'a poussée à braver mon incompétence et à tenter d'ouvrir un Wiki, aussi simple soit-il.
Un cheminement de penser, des mots qui en conservent la trace. Répondre à l'appel de l'inconnu plutôt que aller vers l'inconnu. Une passivité active, sensible à tout ce qui va (m') arriver.
Donner accès à la lecture de ce cheminement comporte un risque puisqu'il s'agit d'abord d'avancer moi-même sans savoir où je vais, et de constater, après-coup, d'observer, là où j'ai « mis les pieds ». C'est un peu projeter en avant de moi ma propre énigme. Je risque, on verra bien… (8 septembre 2012)
25/26 janvier 2012
note 01
L'acte de copier, l'acte de déposer, la question du ruban (de la forme). À classer dans « Les derniers livres traditionnels » ? Comme si j'attendais qu'il me dise quelque chose — dans sa forme —.
C'est surtout la question de l'écriture qui y « trouve asile » (Bon/Benjamin, p. 141) qui me questionne : ceci pour m'expliquer le choix d'en passer par le livre pour aller vers une forme numérique qui ne soit pas la copie conforme du livre, ce qui aboutirait à le réduire à une simple source documentaire. Le changement de support doit me porter vers, me faire découvrir d'autres potentialités de ce ruban, pour l'instant couché-plié en double colonne sur du papier.
mars 2012
note 02
10 avril 2012
note 1
note 2
note 3
11 avril 2012
note 4
13-17 avril 2012
note 5
- La notion de page, et surtout de double-page (cf. livre d'art)
- La notion de fragment
- La notion d'unité non achevée (le livre sans fin)
- La notion de ruban
- La notion de coupe/collure
- La notion d'interruption
- La notion de lecture, ses niveaux et ses vitesses différents
- La notion de mouvement
- La notion de surimpression, transparence, fondu enchaîné (PJ Laffitte)
- La notion de tissage (« contradiction dynamique » chez Rabant), de texte (qui associerait la coupe - le lien, la structure logique - avec l'expansion spatiale).
1er juin 2012
note 6
Dans l'acte de parole, c'est le corps tout entier qui est mobilisé. Je pense tout à coup à la notion de corporéité dans Passage…. Il n'y a pas d'images, mais, à travers la parole, de la corporéité. La parole fait écho aux corps de ceux qui parlent plus qu'au cinéma.
Recevoir ces paroles en silence (Balat, p. 15)
Le caractère corporel de l'écriture (gigoter, les végétatifs, nous oublions que nous écrivons, le leib).
Ce n'est pas automatique. C'est un acte « tessserisé »
La tessère : un porte-type, porte une inscription.
Le corps tesserisé. Le « corpensée ».
p. 20 : La théorie pour observer, rendre compte, ne pas être en contradiction avec l'observation, nous permettre d'observer des choses nouvelles, produire quelque chose.
Nous décidons d'être à un certain niveau de lecture (p. 21) (dans la rotation des fonctions)
note 7
Début de relecture de Passage, …
C'est vraiment un discours à partir de la pratique du cinéma sur son propre objet. Introduire des images serait aberrant. Quid de l'aspect socio, historico, esthético, anthropologico, psychologico, … ???
C'est la forme, pas le contenu en soi, qui génère le récit.
En fait, ce que les interviewés disent, c'est en réaction à une situation, par rapport à quelque chose de concret.
Bresson, n. 5619 : le son qui creuse les images (Cf. Fargier)
Cocteau, amateur, n. 154 : cf. avec « le plus important, ce n'est pas le cinéma »
2 juin 2012
note 8
note 9
Grosse tête : pas au sens péjoratif habituel :
La lecture en continu brasse tellement d'idées différentes, de points de vue… mais comme c'est en continu cela devient comme un seul point du vue : un oeil à multiples facettes : comme un oeil de mouche ? Les points de vue ne se mélangent pas. Ils conservent dans ma mémoire leur couleur, leur ton, leur rythme, leurs anecdotes. Mais ça crée comme une masse proliférante.
Me vient l'image de ces multiples bulles générées par le souffle de l'enfant dans l'eau savonneuse du bain.
note 10
note 11
L'échafaudage qui a permis cette construction a disparu. Mais là, ça tient. Ce travail de « petite main », le travail du montage.
note 12
Fausse interprétation. Le rapport à l'argent marqué par les cultures qui ont développé le commerce et les échanges pour finir par accueillir à bras ouverts le capitalisme.
note 13
Sur la typo : je trouverais gênant une typo moderne pour des fragments anciens.
3 juin 2012
note 14
Cela a été ma méthode pour construire les liens-passerelles mais chaque nouvelle lecture engendre un nouvel embrayage de la mémoire. À l'heure qu'il est, si je m'écoutais, j'en rajouterai un paquet de ces liens (et d'ailleurs, il n'est pas dit que je ne succombe pas… remarque qui fait présumer l'aspect moral, surmoïque qui, l'air de rien, jette un oeil sur le projet…)
À frustration, frustration et demie : celle du lecteur (futur, tout au moins je l'espère !) qui va se retrouver pris dans le même bain : « Tiens, ça me fait penser à…. Sauf qu'il n'y a aucun moyen (ni index ni fonction 'rechercher' sur lequel se reposer. Le lecteur va donc se retrouver avec sa propre mémoire en quête d'un outil pour diminuer, anéantir la tension-douleur psychique provoquée. Principe de plaisir, principe de réalité, quand tu nous cherches….)
note 15
Je lis donc d'affilée. Le mot de l'entrée ne me passe pas inaperçu mais je ne m'y arrête pas. Je file. Et du coup je ressens les blocs de fragments comme des vagues, des vagues de thématiques différentes qui se recouvrent les unes les autres. Arrivée à la page 127, c'est la sensation de densité qui prime. Cette densité me semble dûe au fait que toutes les périodes sont représentées, et dans le désordre. Cette discontinuité permet à chacune de garder tout son poids. D'ou peut-être ce que j'appelle cette « densité » (en tout cas c'est le terme qui m'est venu spontanément.) À suivre…
note 16
4 juin 2012
note 17
note 18
note 19
note 20
note 21
note 22
note 23
note 24
note 25
note 26
note 27
note 28
5 juin 2012
note 29
Je ne peux rien contre l'ordre alphabétique si je l'ai choisi comme arbitraire.
Après les généralités ciné, cinéma, cinéphilie, cinemascope, etc… Voici qu'arrive collure et là, pour moi (qui y sera sensible ?) c'est un certain bonheur. Cela fait partie de ce qui m'importe le plus au cinéma (ce qui veut dire : pour moi, tout aussi bien dans la fabrication que dans l'écoute, car la collure est pour moi une affaire sonore. (À travailler avec la question du rythme). Même si ça commence par des hisoires de fondu enchaîné. Comment le lecteur va-t-il recevoir tout ca ? Va-t-il supposer dans ce qu'il lit mes affinités électives ?
6 juin 2012
note 30
note 31
Au point où j'en suis (concurrence, concession), je me sens dans les coulisses de la profession. Les problèmes ont toujours été les mêmes mais ils sont toujours nouveaux pour celui qui doit les affronter. Beaucoup de mesquineries, mais aussi des instantanés sur la tyranie de l'argent. Ex : La concurrence du tirage de la Loterie nationale (pour les exploitants).
Tous les champs sont abordés par le biais du medium cinéma.
Avec condition humaine et connaissance on en est à la philo.
Aborder l'histoire dans ses moments les plus tragiques par le biais d'une banale question technique (les ordonnances allemandes en 1942).
note 32
7 juin 2012
note 33
On entre par surprise dans un échange entre deux personnes qui nous ignorent. Elles font allusion ici à un traité franco-américain. Je suis poussée dans la lecture par ce tison : de quel traité s'agit-il ? Peu importe : on comprend que c'est encore un épisode de la bataille sans merci autour de l'argent, cette fois-ci dans une version franco-allemande. On est en 1936.
note 34
note 35
8 juin
note 36
Au fur et à mesure que la lecture s'allonge, qu'elle prend un certain rythme, je m'apercois que je commence à attendre le saut occasionné par le changement d'entrée. Sur mon petit notebook je ne peux pas trop le prévoir car je ne vois qu'un tiers de la page. Donc mon subconscient attend la suite-surprise. Ce n'est pas la suite de l'histoire car il n'y a pas d'histoire, pas de chronologie. C'est comme une suite intériorisée de ce qui se passe en moi, ce que je construis à partir de tous ces morceaux. Mais c'est le propre de toute lecture ! Alors, ici, qu'est-ce qui change ?
note 37
Comment travailler la possibilité ?
C'est la publication qui peut être envisagée sur le registre de l'impossible.
(Essai de logique triadique…)
Mais le livre est dans une position seconde par rapport au travail en soi qui fait que ce projet est ce qu'il est en dehors de toute publication. Il est lui même en position seconde par rapport à tous les textes qui ont existé dans les revues… qui eux-mêmes sont en position seconde par rapport aux paroles énoncées par certaines personnes à un certain moment de leur existence. Car on voit bien que c'est d'une certaine existence dont il s'agit à chaque fois.
Mais dans ces « chaque fois », la « certaine » existence nécessite un élément premier qui a été second précédement mais qui en même temps représente cette chaîne et nous y donne accès.
Dans cette chaîne, chaque élément se retrouve donc dans une des trois positions : une position première de possibilité, une position seconde d'existence et une position troisième qui nous en permet l'accès. C'est bien parce que cette chaîne existe (position seconde) que je peux développer tout ce travail d'interprétation qu'est le Wiki à partir de la possibilité d'un livre que j'ai classé initialement, d'une manière très hasardeuse, dans la série dyadique du livre impossible (qui n'a que deux choix : possible/impossible).
La publication occuperait à un moment donné la position 3 comme signe d'existence d'un certain travail, mais en attendant cela n'empêche pas d'autres formes d'existences d'émerger et ces émergences entretiendront la chaîne.
C'est bien pour ça que la possibilité d'une non-publication n'a pas vraiment été accompagnée de signes de dépression de ma part.
Tout ce système fonctionne en dehors de moi (mais pas tout seul).
10 juin 2012
note 38
11 juin 2012
note 39
L'index est la production du travail du scribe et du manticien. Une interprétation.
Production (faire) ou produit (d'une opération)
Distinguer mais pas séparer.
Une forme-rythme à distinguer de la forme-sculpture. Gestaltung.
Michel Balat, Causeries de Canet, 7 mars 2005, Sémiotique (dans le langage)
Poiétique : laisser être la Gestaltung, la forme-rythme.
Sur le plan sémiotique, ça produit de l'interprétation.
Sur le plan poiétique, ça laisse être un rythme, principe, fondement de l'oeuvre, qui ne relève pas de l'espace-temps. Ça permet… cf. Balat (mieux observer et produire)
12 juin 2012
note 40
Le fait de taper les fragments : comme une incorporation.
14 juin 2012
note 41
Pas définition fixe, plutôt du côté de « l'hypothèse abductive » (Cf. Balat et Oury)
Mais à la lecture le parcours est inversé : on lit en premier ce qui est arrivé en dernier (l'index et même, le titre !). Tout le travail aura conduit à l'entrée (au terme choisi pour faire entrée). D'où parfois le caractère énigmatique du rapport fragments/entrée dans ce temps paradoxal : quand le futur décide du passé.
Les fragments sont des possibilités, lien avec abduction.
Quel lien avec métaphore et métonymie ?
Le mot qui fait entrée comme une métaphore pour donner accès au sens construit par la série des fragments ( différent de signification)
Alors, pour l'ensemble, le titre fait « entrée » : premier et pourtant dernier élément du montage.
L'énigme est d'autant plus complexe que toute trace qui témoignerait de l'ouverture (la création) de l'entrée par le premier fragment retenu est inexistente.
Les chiffres sont l'indice d'une tout autre opération (dans le temps de chronos, celle-là).
Balat : Lesens, création continue
Iconique, un truc qui passe.
Signification, totalité, entéléchie du signe : à travailler.
Michel Balat, Causeries de Canet, 16 novembre 2009
Le dernier (né) vient dire ce qu'aura été la structure, du fait qu'il arrive. Aucun des autres ne peut le faire puisqu'il y en a un qui vient après. C'est lui qui vient fonder car il la clôt.
Le titre, passage du cinéma, 4992, trouvé en dernier.
Être à l'origine, au sens du futur antérieur.
La fonction et la place de tous les titres venus avant.
Entre le titre (titoli di testa) de début (« Passage du cinéma, 4992 ») et le titre (titoli di coda) de fin ( « Le reste manque ») …
Devinement : non, c'est plutot un produit du musement (Balat).
Sans les entrées, qu'est-ce que ce serait ?
Sans la numération, qu'est-ce que serait ?
Il n'y a pas de 0, mais il y a une place pour le reste qui manque, ce n'est pas une opération sans reste, totale (?)
Dans Passage…, il n'y a pas de dernier, il y a toujours un successeur possible au sein du reste qui manque (réservoir des possibles).
Le dernier clôt, interprétable comme groupe.
Le titre à la place du zéro ?
9/10/11 juillet 2012
note 42
Quand le rapport entre le mot de l'entrée et les fragments qui sont montés engendrent de l'énigme. Je pense à deviner, par exemple.
Dans cette lecture en continu, il me vient une autre métaphore, celle du raz-de-marée. Parfois, Cela change tellement d'un fragment à l'autre, qu'on n'a pas le temps de se relever de terre qu'on est déjà renversé par la vague suivante (souvenir d'enfance lorsqu'on s'accroupit au bord du rivage pour toucher un peu l'eau mais que le courant nous déstabilise).
En lisant éclairer, j'ai envie de visionner chaque scène dont parle l'interviewé. J'imagine (sans pouvoir me le représenter) un film composé de chacune de ces scènes, parfois même de ces plans.
19 juillet 2012
note 43
Parfois je suis déroutée par les entrées. Cela devient comme un titre. Un titre qui peut leurrer ou créer de l'énigme (fantasme) ou bien ouvrir vers une remise en question : Pour feed-back, je vois bien ce qui construit le montage mais la question de la circularité (dans le fragment de Manoel de Oliveira) fait (me fait) problème. C'est comme si il y avait un récit avec des emboîtements, des fausses pistes, des traquenards. Mais où est le personnage principal (s'il y en a un) ? C'est quoi le moteur ou l'alibi qui a fait démarrer cette histoire ? Les parlants, ces personnages convoqués pour répondre — de quoi ? (là encore, Manoel de Oliveira)
note 44
Sentiment très passager, remplacé aussitôt par un autre puisque, au début du montage tout au moins, cela concerne la fenêtre du projecteur.
20 juillet 2012
note 45
Renoir parle (fonction du cinéma) de la marche des jeunes filles hindoues, de leur façon de poser le pied, significative de leur pays, qui nous est absolument étrangère. Je pense à faire un lien avec Bergman ou Ruiz, dans exotisme. Si, de ce lien, le lecteur en déduit que je pense que Renoir tombe dans l'exotisme, c'est qu'il en reste à une objectivité des choses, une positivité. La mise en rapport ne se ferait que pour signaler des situations identiques, équivalentes, positives. Bien sûr que non, la mise en rapport, destinée à comparer, ne préjuge pas de l'intention et n'aboutit pas automatiquement à une déduction immédiate. Ici, en l'occurrence, si je maintiens le lien entre les deux, ce sera justement pour esquisser une différence, entre la position de Renoir et l'évocation de Bergman. C'est quelque chose de vague, très imprécis, qui demanderait comme une rêverie pour en savoir plus…
Orson Welles dit quelque chose qui va dans ce sens. Il doit également y en avoir un autre, mais je n'arrive pas à faire remonter à la surface le souvenir…
note 46
Comme je ne cherche pas une définition qui deviendrait une référence, une autorité, un mètre-étalon, les montages que j'élabore sont plutôt destinés à jouer avec les mots. J'introduis le jeu dans tous les sens du terme, sauf un : le jeu qui s'opposerait au travail, à ce qui coûte, afin d'éviter tout effort. Comme dans la formulation d'il y a un certain temps : l'éducation sucrée. Lorsqu'on voulait gaver les oies de savoir sans en avoir l'air.
27 août 2012
note 47
Rassurée. Comme souvent, ce qui se construit dans le montage ne relève pas d'une définition avec accumulation d'éléments 'positifs', 'affirmatifs'. Mais c'est vrai, on bute, on s'étonne : cela a pour premier effet une seconde lecture d'un ou plusieurs fragments qui du coup vont prendre plus de relief, acquérir plus de densité.
Les fragments qui composent l'entrée hors-champ en font apparaître un aspect analytique, critique, contrastant avec le concret des descriptions ou récits composant hors-cadre. Je ne sais pas si la critique cinématographique ou la recherche en cinéma vont dans ce sens en ce qui concerne la distinction entre ces deux termes. En tout cas, c'est ce que je constate dans la lecture d'aujourd'hui.
Je ne me souviens pas en être arrivée là dans les précédentes lectures. Totalement oublié également si ce type de remarque a été fréquent.
note 48
Y a-t-il une entrée symbolique, langage ? (pas le courage d'aller au fichier index).
Dans la remarque de Silver (6732) on se rend bien compte que le langage ce n'est pas aligner des mots ; que quelque chose qui articule, sert de base à tout mon psychisme est toujours là même quand me viennent effectivement des images associées à ce que j'ai fait dans la journée.
(langue, langage, parole - cf. Oury/Lacan)
Le jour où j'arriverai à dire ça clairement !…
28 août 2012
note 49
18 septembre 2012
note 50
Il y a des fragments que je reconnais comme certains plans de cinéma (dans À bout de souffle, par exemple). « Je n'aime ni la lecture ni la récitation… », Téchiné, n. 1496. Ce sont de fragments, qui figurent dans le tapuscrit depuis le début. Je les ai tellement fréquentés ! À chaque relecture, à chaque fois que je cherchais à introduire dans le montage un nouveau fragment.
note 51
note 52
note 50bis
25 septembre 2012
note 53
2 octobre 2012
note 54
« … des carters, des cuves à eau, des chiffons mouillés, des syphons,… »
Si le mot ne figurait pas dans une liste à la Prévert (qui est l'équipement nécessaire d'une cabine de projection !), qui sait si je n'aurais pas rétabli le « i » ?
25 octobre 2012
note 55
28 octobre 2012
note 56
Je fais le lien avec la notion de fragment.
Qu'est-ce qui se passe dans un faux raccord : 1/il met en rapport deux choses qui ne devraient pas se suivre. On pourrait dire que cela implique une vision linéaire du temps (chronos), avec un début et peut-être même un fin (dans tous les sens du terme) même si c'est l'infini ; 2/il met en rapport deux choses qui n'ont rien en commun, non sur le plan quantitatif mais sur le plan qualitatif (ex. faire un raccord à partir de deux objets de couleur orange. Je l'ai fait.) Quel type de temps cela implique-t-il ? Ce serait un temps qui s'actualise à chaque fois qu'il surgit : une association d'aion et kairos. D'où la nécessité d'être instruit sur les différentes modalités temporelles possibles sans en rester à l'impression empirique de chronos (passé-présent-futur).
Un montage de fragments peut prendre spatialement la forme d'un ruban mais cette forme est l'aspect d'une « construction » qui ne peut être décrite si l'on reste dans une représentation perceptive du monde.
C'est une construction qui n'est pas objective au sens où cela ne relève pas de l'objet que nous avons devant nous en tant que sujet. C'est beaucoup plus primordial.
C'est là que la phénoménologie du sentir telle que Erwin Straus l'a proposée peut nous être utile.
Raccord, collure, coupure… des termes qui ne sont plus de mise… et pas même rapport … C'est de contact qu'il va être question.
8 novembre 2012
note 57
Mais que serait un symptôme sans énigme ? En tout cas, pas un symptôme. Alors, le montage devient lui-même un symptôme.
Si, dans ce cas, la lecture ne se fait pas flottante (comme l'attention flottante de la technique freudienne), ça peut faire mal !
9 novembre 2012
note 58
1er décembre 2012
note 59
Certains microfilms sont comme en négatifs : la page est noire, les lettres sont blanches. Les appareils, à la BNF, sont dans des espaces où la lumière du plafond aveugle la table de lecture sur laquelle vous visionnez les pages du microfilm. Souvent, si vous demandez aux autres consultants d'éteindre les plafonniers, ils refusent.
De plus, les microfilms ont été photographiés sans aucune sympathie avec le futur lecteur. Les couvertures des revues — parfois, sont détachées des numéros et regroupées en fin de bobine. Vous ignorez donc les références (numéros, dates), ce qui vous obligent à compter — à partir du premier numéro de la bobine — pour véritablement dater le numéro que vous êtes en train de lire.
Pour compliquer la consultation, les bobines de microfilms ne sont pas forcément annuelles. Parfois, surtout dans les revues anciennes, une année de publication se retrouve sur des bobines différentes. Et… cerise sur le gâteau : les photographies semblent prises par des machines, sans contrôle par une personne humaine. Je m'explique : dans certaines revues les références — années, numéros, — sont illisibles car la page de couverture originale est trop foncée. Au final, vous devez être un véritable Sherlock Holmes pour définir la référence de la citation que vous choisissez dans la revue concernée.
Cette relecture à partir des microfilms me provoque une nausée (je me suis penchée sur ces tables de lectures inconfortables pendant des années !), mais pas seulement.
Je pense aux techniciens qui ont qui ont fait fonctionné le scanner. Ils voyaient bien qu'on n'y voyait rien. À condition de ne pas fonctionner en tout automatique. Les conditions de travail actuelles, les rendements, etc… font qu'ils ne sont plus en mesure d'être en sympathie avec les usagers.
Les techniciens ont fait leur boulot, comme on dit. Comme des robots. Des aliénés. Sans penser aux autres êtres humains qui allaient lire le résultat de leur travail.
16 décembre 2012 - 20 janvier 2013
note 60
(Projet pour une 4e de couverture)
Une forme s'est mise à apparaître.
Une forme composée, au bout du compte, de 4992 fragments d'écriture travaillés chacun comme un plan de cinéma à la table de montage : la délicate opération de la coupe (cut) in et de la coupe out pour construire le film. Ici, le livre.
Pendant une dizaine d'années j'ai lu un grand nombre de revues — consacrées au — ou concernées par — le cinéma, depuis son acte de naissance (1895) jusqu'à l'aube du nouveau siècle (2000). Lecture qui s'est faite écoute : jetant mon dévolu sur les propos notés, rapportés ou enregistrés (au gré des époques) et finalement imprimés, de représentants du monde professionnel cinématographique (techniciens, industriels, producteurs, exploitants, cinéastes, acteurs…)
De ces flux de paroles devenus blocs d'écritures, j'ai élu, retenu 4992 fragments, retranscrits et numérotés, méticuleusement.
La lectrice se fait scribe.
Une autre décennie a été nécessaire pour assembler, ordonner, relier, modeler, façonner-fictionner ces fragments tout autour d'un abécédaire personnel. Une volumineuse matière plastique devenue un long ruban plié en double colonne sur les pages de ce livre.
Scribe, je me fais monteuse et plasticienne.
Suivant quel(s) récit(s) ? Au service de quelle(s) histoire(s) ?
Dans le temps de la lecture, Passage du cinéma, 4992 donne à imaginer ces voix singulières, ces corps uniques, initiateurs de récits, de savoirs et d'histoires qui nourrissent l'Histoire, échafaudant une grande pièce montée anachronique.
Chaque fois qu'il ouvrira le livre, en tournant les pages, vers l'avant comme en arrière au moyen d'un entrelacs de mots-passerelles, le lecteur activera à son tour la cadence pour d'autres montages, d'autres formes, d'autres rythmes. À lui de deviner sa propre guise.
17 décembre 2012
note 61
Le livre tient une drôle de place ou plutôt occupe des places différentes selon la logique dans laquelle on l'inscrit.
Je peux dire par exemple que c'est l'objectif, la finalité de mon projet démarré au début des années 90 (composer un livre de fragments).
Je peux dire aussi que c'est la version majeure de mon projet. Comme il y a une version chiffrée colorée, comme il y a une version plastique, le totem éphémère. Comme si ces trois versions étaient des traductions de la même chose, dans des langues différentes. Il n'y a pas un original et des copies. Il y a des versions, des traductions, même si l'une (le livre) écrase toutes les autres. Je me plais à imaginer, par exemple, une version musicale. J'imagine que cela pourrait avoir affaire avec les algorithmes, par exemple. Mais je n'ai aucun savoir sur ce qu'on appelle les « langages informatiques ».
En tout cas, ce dont je suis certaine, c'est que le ruban tel qu'il est déposé sur les pages blanches de mon tapuscrit au format 21×29,7 ne peut se donner à lire que sur du papier, des pages réunies dans un livre-papier. La lecture dépend, entre autre, de la manipulation de l'objet (cf. note 60). C'est vraiment paradoxal puisque ce livre fait avec deux mains, par une seule personne, serait impensable même à l'ère de la Remington portative ! (cf. la photo en haut de ces notes).
Me vient alors l'idée que mon projet n'est pas terminé, une fois le livre édité. Qu'une version non pas — numérique (le livre papier est fait avec des outils numériques) — mais qu'une version Web — est à inventer. Une version qui, celle-là, devrait être une aventure collective, chorale (avec qui ?).
18 décembre 2012
note 62
En ce moment je suis en train de rajouter des liens-passerelles. Je suis constamment en train de faire des aller-retour dans le tapuscrit. Pour suivre les fils de liens existants, pour chercher un fragment que je voudrais relier à un autre. En cours de route, ma pensée s'échappe. Je me désintéresse de ce qui était à l'instant même l'objet de mon attention pour être agrippée par un nouveau fragment puis, je reviens au précédent, etc… Dans cette manipulation, je m'aperçois que je « construis » quelque chose, que cela a pour effet de me stimuler encore davantage. Cela me met en marche si je peux dire. Mais ce me n'est pas mon moi. C'est quelque chose qui agit malgré moi. Ça vient tout seul.
20 décembre 2012
note 63
J'ai toujours été très attentive à la coupe (in et out) pour faire sentir la blessure. Que le fragment lui-même devienne comme un appel pour retrouver ce qui lui manque. En ce sens-là aussi, le livre est un passage : incitation au retour vers là où j'ai trouvé ces propos. D'où mon soin presque excessif pour détailler les éléments de référence dans la parenthèse qui clôt ce corps hétérogène mais soudé qu'est chaque bloc d'écriture.
« corps hétérogène mais soudé » c'est-à-dire ?
C'est un corps composé de trois parties qui ne doivent pas être séparées (donc pas de retour à la ligne) : le nombre (trace de mon temps de travail), les paroles écrites, la référence. Tout compte. Tout peut faire sens. On n'est pas dans un dictionnaire ou une encyclopédie donnant des définitions ou des significations. Même si cet élément y est. Mais il y a autre chose.
Ce qui peut faire sens, nul ne le sait d'avance. Cela ne se saura qu'après coup. Lorsque l'on aura pu constater des effets déclenchés par un mot, une phrase, un fragment, un titre d'article, le nom d'un film, etc… Quelque chose… parfois un détail de rien du tout qui va mettre en marche notre penser, qui va nous faire tourner les pages, en avant, en arrière, va et vient incessant. Les mains aussi importantes que les yeux.
Dans la manipulation du livre (ce que j'expérimente en ce moment avec mon tapuscrit), il y a quelque chose qui dépasse le modèle du montage cinématographique (le rapprochement des plans qui construit du sens-signification).
23 décembre 2012
note 64
Me vient cette idée encore pas très claire que le livre, donc de la version papier du projet, serait un objet de survivance (comme l'entend notamment Didi-Huberman) qui aurait traversé l'ère numérique.
24 décembre 2012
note 65